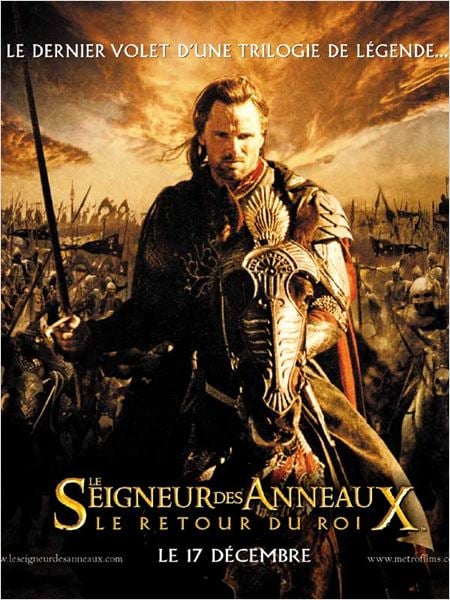Ce message pourrait s'intituler "De l'évolution du métier d'enseignant-chercheur". Je n'en ai bien sûr qu'un aperçu tout à fait modeste, mais le peu auquel j'essaie de participer dans la vie de mon département et qu'il m'arrive de raconter en rentrant à la maison amène souvent la même remarque dans la bouche de mon copain.
Ça a commencé avec les inscriptions pédagogiques. J'y participe tous les ans et je considère que c'est normal : plus on est à y donner un coup de main, plus vite elles se font, pour nous comme pour les étudiants (qui ont du coup, soit dit en passant, une meilleure image de leur fac que s'ils devaient attendre des heures le ventre creux avant de pouvoir enfin s'inscrire). On s'y retrouve donc généralement entre doctorants, ATER et maîtres de conférence ; aucun prof, mais il est vrai qu'ils sont généralement plus occupés que nous, entre soutenances de thèse, colloques et sociétés savantes (les maîtres de conférence aussi ont ça, mais peut-être moins qu'eux ?). Lorsque je suis rentrée à la maison, Monsieur mon copain m'a demandé pourquoi on s'en chargeait, alors que c'était à l'administration de le faire, ce qui faisait écho à une remarque de mon directeur à ce sujet : "Je ne comprends pas pourquoi on nous demande ça : avant, c'était le travail des secrétaires et nous intervenions seulement lors des cas difficiles."
Même chose pour une histoire d'emploi du temps : un de mes collègues hellénistes chargé d'un cours de master a obtenu un congé de recherche pour le premier semestre, l'autre chargé de cours étant mon directeur. D'habitude, soit ils s'alternent une séance sur deux, soit ils font chacun six séances. Je m'attendais donc à ce que Chef fasse cours tout le premier semestre et mon collègue tout le second, mais Chef a l'air parti pour faire comme d'habitude, une séance sur deux, ce qui, je le crains, augure un encombrement pour le grec à partir de février. J'en parle en passant à Chéri, qui me dit : "Mais la secrétaire ne pouvait pas contacter Chef, pour lui dire qu'il faisait cours tout le premier semestre ? Ce n'était pas à lui de penser à ça !"
Dernier épisode en date : je suis sur le point de publier un article dans le Bulletin de l'Association Guillaume Budé ; l'imprimeur m'a donc envoyé deux jeux d'épreuves, un à garder, un à corriger et à lui renvoyer. Je me suis donc appliquée à inscrire au stylo rouge des signes cabalistiques dans les marges et sur le texte, lorsque Chéri arrive et, après avoir su ce que je faisais, me demande à nouveau : "Mais il n'y a pas de correcteur professionnel, dans cette revue, pour vérifier qu'il n'y a ni fautes d'orthographes, ni fautes de typo ?"
Evidemment que, dans un monde parfait, il y aurait trois secrétaires pour notre département, qui pourraient s'occuper des emplois du temps des étudiants et des professeurs en plus du reste, et chaque revue aurait des correcteurs (la plupart en ont quand même, il me semble, bien que j'aie entendu dire que certains éditeurs allaient jusqu'à s'en séparer).
Mais le fait est que le métier d'enseignant-chercheur comprend depuis un bon moment des tâches administratives de plus en plus lourdes. Le temps où il se contentait d'arriver et de délivrer sa science aux étudiants est bien fini (s'il a jamais existé) : il faut maintenant aussi s'occuper des relations avec les facs, les lycées et les classes préparatoires ; cogiter sur les nouveaux emplois du temps ; prévoir les remplacements de collègues malades/en détachement/en congé maternité/avec des décharges horaires ; se concerter sur les nouvelles maquettes de diplômes et faire des recherches avant de les monter ; assurer des permanences pour aider les étudiants qui en ont besoin ; assister à diverses réunions, dans l'UFR, avec d'autres UFR, au sein de l'université, etc., etc. (je suis encore très loin du compte).
Ce n'est pas scoop, ça fait longtemps que les enseignants-chercheurs français disent à qui veut l'entendre qu'on les assomme d'administratif et que ça les empêche de faire à la fois cours et de la recherche dans les meilleures conditions. Ça fait aussi longtemps que les Américains, quand ils viennent faire un tour chez nous ou discutent avec eux, sont ébahis de voir ce qu'arrivent à faire leurs collègues français, alors qu'ils ont une masse de tâches annexes à gérer en plus. Parce qu'il n'est pas possible de faire comme si notre seule secrétaire travaillait sept jours sur sept, avec des journées de quarante-huit heures. Parce qu'il n'est pas possible non plus de faire comme si le collègue chargé de l'ensemble de la licence avait, lui aussi, de super pouvoir temporels ou un clône (voire deux) lui permettant d'aller tranquillement en bibliothèque pendant que le reste se fait tout seul.
Personnellement, je ne râle pas trop : d'abord parce que ce n'est pas (encore, espérons-le) mon problème, ensuite parce que j'ai un caractère tel qu'il me paraît normal d'essayer d'aider en se répartissant le travail (c'est comme pour les inscriptions pédagogiques : plus on est, moins chacun en a à faire) ; les conditions d'exercice changent, à nous de nous y adapter pour essayer de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles.
En même temps, je comprends aussi ceux qui se refusent à s'occuper de cela, parce qu'ils considèrent qu'ils ont autre chose à faire et que ce n'est pas pour assurer ces fonctions qu'ils ont été embauchés. Il est vrai qu'on peut aussi craindre que se charger de tâches administratives toujours plus lourdes n'incite les décideurs à en imposer toujours plus, en rognant davantage encore sur, par exemple, les fonds alloués pour embaucher des secrétaires et des ATER (parce qu'on ne parle pas assez non plus des profs en archi-surservices, avec des heures de cours sur l'année qui dépassent bien largement les 192 pour lesquelles ils sont payées - oui, vous avez bien lu, certains cours, faute de mieux et par conscience professionnelle, sont effectués gratis).
Accepter de se charger de tâches administratives nouvelles, c'est mettre le doigt dans un engrenage sans fin, dont on sait que, sauf retournement inespéré de la conjoncture économique et/ou de l'attitude de la société française face à l'enseignement et à la recherche, il y a peu de chance qu'on sorte "vainqueur". Pourtant, refuser de le faire, c'est aussi profiter assez égoïstement de la surcharge qu'on fait peser sur tous les autres.
Ça a commencé avec les inscriptions pédagogiques. J'y participe tous les ans et je considère que c'est normal : plus on est à y donner un coup de main, plus vite elles se font, pour nous comme pour les étudiants (qui ont du coup, soit dit en passant, une meilleure image de leur fac que s'ils devaient attendre des heures le ventre creux avant de pouvoir enfin s'inscrire). On s'y retrouve donc généralement entre doctorants, ATER et maîtres de conférence ; aucun prof, mais il est vrai qu'ils sont généralement plus occupés que nous, entre soutenances de thèse, colloques et sociétés savantes (les maîtres de conférence aussi ont ça, mais peut-être moins qu'eux ?). Lorsque je suis rentrée à la maison, Monsieur mon copain m'a demandé pourquoi on s'en chargeait, alors que c'était à l'administration de le faire, ce qui faisait écho à une remarque de mon directeur à ce sujet : "Je ne comprends pas pourquoi on nous demande ça : avant, c'était le travail des secrétaires et nous intervenions seulement lors des cas difficiles."
Même chose pour une histoire d'emploi du temps : un de mes collègues hellénistes chargé d'un cours de master a obtenu un congé de recherche pour le premier semestre, l'autre chargé de cours étant mon directeur. D'habitude, soit ils s'alternent une séance sur deux, soit ils font chacun six séances. Je m'attendais donc à ce que Chef fasse cours tout le premier semestre et mon collègue tout le second, mais Chef a l'air parti pour faire comme d'habitude, une séance sur deux, ce qui, je le crains, augure un encombrement pour le grec à partir de février. J'en parle en passant à Chéri, qui me dit : "Mais la secrétaire ne pouvait pas contacter Chef, pour lui dire qu'il faisait cours tout le premier semestre ? Ce n'était pas à lui de penser à ça !"
Dernier épisode en date : je suis sur le point de publier un article dans le Bulletin de l'Association Guillaume Budé ; l'imprimeur m'a donc envoyé deux jeux d'épreuves, un à garder, un à corriger et à lui renvoyer. Je me suis donc appliquée à inscrire au stylo rouge des signes cabalistiques dans les marges et sur le texte, lorsque Chéri arrive et, après avoir su ce que je faisais, me demande à nouveau : "Mais il n'y a pas de correcteur professionnel, dans cette revue, pour vérifier qu'il n'y a ni fautes d'orthographes, ni fautes de typo ?"
(Socrate, prof de Platon ; Musées du Capitole, Rome ; photo personnelle)
Evidemment que, dans un monde parfait, il y aurait trois secrétaires pour notre département, qui pourraient s'occuper des emplois du temps des étudiants et des professeurs en plus du reste, et chaque revue aurait des correcteurs (la plupart en ont quand même, il me semble, bien que j'aie entendu dire que certains éditeurs allaient jusqu'à s'en séparer).
Mais le fait est que le métier d'enseignant-chercheur comprend depuis un bon moment des tâches administratives de plus en plus lourdes. Le temps où il se contentait d'arriver et de délivrer sa science aux étudiants est bien fini (s'il a jamais existé) : il faut maintenant aussi s'occuper des relations avec les facs, les lycées et les classes préparatoires ; cogiter sur les nouveaux emplois du temps ; prévoir les remplacements de collègues malades/en détachement/en congé maternité/avec des décharges horaires ; se concerter sur les nouvelles maquettes de diplômes et faire des recherches avant de les monter ; assurer des permanences pour aider les étudiants qui en ont besoin ; assister à diverses réunions, dans l'UFR, avec d'autres UFR, au sein de l'université, etc., etc. (je suis encore très loin du compte).
(Platon, élève de Socrate et prof d'Aristote ; Musées du Capitole, Rome ; photo personnelle)
Ce n'est pas scoop, ça fait longtemps que les enseignants-chercheurs français disent à qui veut l'entendre qu'on les assomme d'administratif et que ça les empêche de faire à la fois cours et de la recherche dans les meilleures conditions. Ça fait aussi longtemps que les Américains, quand ils viennent faire un tour chez nous ou discutent avec eux, sont ébahis de voir ce qu'arrivent à faire leurs collègues français, alors qu'ils ont une masse de tâches annexes à gérer en plus. Parce qu'il n'est pas possible de faire comme si notre seule secrétaire travaillait sept jours sur sept, avec des journées de quarante-huit heures. Parce qu'il n'est pas possible non plus de faire comme si le collègue chargé de l'ensemble de la licence avait, lui aussi, de super pouvoir temporels ou un clône (voire deux) lui permettant d'aller tranquillement en bibliothèque pendant que le reste se fait tout seul.
Personnellement, je ne râle pas trop : d'abord parce que ce n'est pas (encore, espérons-le) mon problème, ensuite parce que j'ai un caractère tel qu'il me paraît normal d'essayer d'aider en se répartissant le travail (c'est comme pour les inscriptions pédagogiques : plus on est, moins chacun en a à faire) ; les conditions d'exercice changent, à nous de nous y adapter pour essayer de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles.
(Aristote, élève de Platon et prof d'Alexandre le Grand ; Musée du Louvre, Paris ; source : Wikipédia Commons)
En même temps, je comprends aussi ceux qui se refusent à s'occuper de cela, parce qu'ils considèrent qu'ils ont autre chose à faire et que ce n'est pas pour assurer ces fonctions qu'ils ont été embauchés. Il est vrai qu'on peut aussi craindre que se charger de tâches administratives toujours plus lourdes n'incite les décideurs à en imposer toujours plus, en rognant davantage encore sur, par exemple, les fonds alloués pour embaucher des secrétaires et des ATER (parce qu'on ne parle pas assez non plus des profs en archi-surservices, avec des heures de cours sur l'année qui dépassent bien largement les 192 pour lesquelles ils sont payées - oui, vous avez bien lu, certains cours, faute de mieux et par conscience professionnelle, sont effectués gratis).
Accepter de se charger de tâches administratives nouvelles, c'est mettre le doigt dans un engrenage sans fin, dont on sait que, sauf retournement inespéré de la conjoncture économique et/ou de l'attitude de la société française face à l'enseignement et à la recherche, il y a peu de chance qu'on sorte "vainqueur". Pourtant, refuser de le faire, c'est aussi profiter assez égoïstement de la surcharge qu'on fait peser sur tous les autres.
(Alexandre le Grand, élève d'Aristote et l'homme qui, entre ses 20 ans et ses 33 ans, a étendu son empire de la Macédoine à l'Inde en passant par l'Iran, en cherchant à inciter les peuples différents placés sous son autorité à se marier entre eux, afin de vivre dans l'harmonie et la paix ; Musées du Capitole, Rome ; photo personnelle)